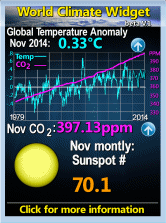woensdag 22 oktober 2008
Syndrome d'aliénation parentale - tables des matières

-Tous droits réservés-
THÈSE
Présentée à l’Université Claude Bernard-Lyon1
Et soutenue publiquement le 22 octobre 2008
Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine
DEDICACE
Pour tous les enfants aliénés,
Pour tous les parents aliénés.
« J’aurais bien envie de voir mon père, mais je me sens comme prisonnière, j’aurais l’impression de trahir ma mère et peut-être elle me rejetterait définitivement… »
Alexandra, 26 ans, victime d’un SAP, handicapée par des attaques de panique chroniques.
« Je refuse définitivement de voir mon père parce qu’à chaque fois que je l’ai au téléphone il se plaint de ne pas assez me voir… »
Sarah, 28 ans, victime d’un SAP, après avoir appelé son père pour la première fois en 6 ans.
« Je me souviens, quand tu étais enceinte de moi de 5 mois,
tu as voulu me tuer… »
Sophia, 13 ans,victime d’un SAP, s’adressant pour la dernière fois à sa mère.
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
FACULTE DE MEDECINE LYON-NORD
par Bénédicte GOUDARD
22 Octobre, 2008
TABLE DES MATIERES
1. INTRODUCTION
2. EXPOSE D’UN CAS CLINIQUE
3. LE SAP
3.1. Définition et étymologie
3.2. Un cas particulier de la relation d’emprise
3.3. Le contexte du SAP
3.3.1. Une séparation conflictuelle
3.3.2. L’entourage
3.3.3. L’hypothèse fausse fonde le SAP
3.3.4. Le temps est un autre facteur non négligeable dans la formation d’un SAP
3.3.5. L’arrivée au SAP
3.4. Description du SAP
3.4.1. Des relations de base faussées
3.4.1.1. La triangulation
3.4.1.2. Réorganisation de la triangulation lors d’un divorce
3.4.1.3. Triangulation et SAP
3.4.2. Le parent aliénant
3.4.2.1. Parent surprotecteur
3.4.2.2. Parent vengeur
3.4.2.3. D’autres motivations inconscientes possibles
3.4.2.4. Le visage du parent aliénant : « je contrôle la situation, rassurez vous mes enfants »
3.4.2.5. Les techniques de manipulation (Voir Figure 4)
3.4.3. Le parent aliéné
3.4.3.1. Impuissance
3.4.3.2. Stress post-traumatique
3.4.3.3. Humiliation et déchéance sociale
3.4.3.4. Fréquence de la perte d’emploi ou d’un reclassement professionnel le rétrogradant
3.4.3.5. Dépression
3.4.3.6. Syndrome phobique et méfiance paranoïde
3.4.3.7. Deuil impossible
3.4.4. Les enfants aliénés
3.4.5. Un abus émotionnel ou psychologique/ la chosification des enfants
3.4.6. Un cercle vicieux
3.5. Conséquences sur l’enfant
3.6. Le beau-parent
3.7. Les nuances
3.7.1. Différence aliénation parentale simple et SAP
3.7.2. Différencier le SAP de situations d’abus
3.7.3. Différencier une crise d’adolescence d’un SAP
3.7.4. Le piège du SAP
3.7.5. Un syndrome contesté, essentiellement par les féministes
3.7.6. Une composante émotionnelle forte
3.7.7. De la question du DSM IV
4. ELEMENTS DE REFLEXION SUR LES APPORTS DU SAP ET TENTATIVES POUR DONNER UNE UNITE A CE SYNDROME
4.1. Un phénomène sociologique
4.2. Ebauche de réflexion sur les mécanismes de base du SAP
4.2.1. Le syndrome des faux souvenirs
4.2.2. La notion de bouc émissaire
4.2.3. Le Syndrome de Stockholm
4.2.4. Le Syndrome de Münchhausen par procuration
4.2.5. La « folie à deux » ou trouble psychotique partagé
4.2.6. Un peu de complexité
5. DEFINIR ET UTILISER LE SAP EN TANT QUE PROFESSIONNEL DE SANTE
5.1. Les stades définis par GARDNER
5.1.1. Léger
5.1.2. Moyen
5.1.3. Sévère
5.1.4. Les mesures préconisées par Gardner aux Etats-Unis
5.2. Evolutions autour du SAP au Canada et dans quelques pays d'Europe
5.3. Le retard de la France
5.4. Quelques recommandations générales aux médecins applicables en France.
5.4.1. Concernant les relations avec le réseau social
5.4.2. Concernant le soutien du parent aliéné
5.4.3. Concernant le rôle du médecin
5.4.4. Les questions essentielles pour un diagnostic rapide
6. CONCLUSION
7. BIBLIOGRAPHIE
8. ANNEXES
8.1. Cas clinique du DR. GARDNER exposant un traitement de SAP au stade moyen
8.2. Lettre d’un enfant à ses parents séparés
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Figure 1 : Triangulation
Figure 2 : Triangulation et divorce
Figure 3 : Triangulation et SAP
Figure 4 : Les techniques de manipulation
1. INTRODUCTION
Le SAP ou Syndrome d’Aliénation Parentale a été décrit pour la première fois en 1985 par Richard A. GARDNER(a), Pédopsychiatre américain, Professeur à l’Université de Columbia, pour définir un certain nombre de situations pathologiques de fréquence croissante associées à des divorces hautement conflictuels. Voici sa définition :
« Le Syndrome d’Aliénation Parentale (SAP) est un trouble de l’enfance qui survient presque exclusivement dans un contexte de dispute concernant le droit de garde de l’enfant. L’enfant l’exprime initialement par une campagne de dénigrement à l’encontre d’un parent, cette campagne ne reposant sur aucune justification. Le SAP résulte de la combinaison de la programmation du parent endoctrinant (lavage de cerveau) et de la propre contribution de l’enfant à la diffamation du parent cible. Lorsqu’un abus et/ou une négligence parentale existent vraiment, l’animosité de l’enfant se justifie et ainsi l’explication de ce comportement par le syndrome d’aliénation parentale ne s’applique pas. »
Le SAP est un sujet explosif qui reste polémique car il concerne autant le milieu judiciaire que médical, et ce, dans des contextes de « guerre parentale » où prendre position est délicat. Il nous vient des Etats-Unis, et reste encore confidentiel en France. La littérature anglo-saxonne est conséquente, mais les articles francophones sont peu nombreux. La justice est réticente à faire entrer dans les cours un diagnostic médical sur un conflit et les médecins se sentent gênés de devoir s’impliquer dans des histoires familiales, qui semblent plutôt relever de la compétence de l’assistante sociale.
Et pourtant, la responsabilité d’un médecin est engagée en tant que premier confident de ces familles. Son devoir, avant tout, est de protéger des enfants, et ceci en conservant une position neutre et bienveillante, mais incitative. Or, l’ignorance du personnel médico-social ne peut que faciliter la cristallisation de telles situations. Et poser un diagnostic est impossible pour un oeil non averti, car vu de l’extérieur, tout va bien. Cependant, ce diagnostic est indispensable, car la prévention est la clé pour préserver la santé mentale de nombreux enfants dans des situations de maltraitance psychologique.
- Richard Alan Gardner est né le 28 avril 1931. Plusieurs de ses ouvrages font autorité en pédopsychiatrie dont « Parental Alienation Syndrome », cités comme références par l’American Psychiatric Association. Professeur à l’université de Columbia de 1963 à 2003, il a été le premier aux Etats-Unis à élaborer des jeux permettant l’expression de l’enfant lors d’une expertise. Frappé par les comportements étranges d’enfants dans des contextes de divorce, il a identifié certains mécanismes et a publié son premier ouvrage sur le SAP en 1985. A partir de ce moment, les parents aliénants, confondus par ses travaux ou dans ses expertises, ont engagé une campagne de critiques et de dénigrement. Le Dr. Michael J. Bone écrit dans un hommage posthume qu’à bien des égards le Pr. Gardner a incarné le parent aliéné type. Il s’est suicidé le 25 mai 2003, à la suite de douleurs neurologiques insoutenables.
2. EXPOSE D’UN CAS CLINIQUE
(le cas clinique a été retiré)
3. LE SAP
3.1. DEFINITION ET ETYMOLOGIE
Le Syndrome d’Aliénation Parentale est un phénomène complexe car insidieux. De fait, il échappe à toute tentative de définition simple, dans la mesure où il existe autant de définitions que de situations familiales. Cependant, tous les enfants atteints présentent des symptômes communs.
Le terme aliénation, qui choque parfois, renvoie à l’étymologie latine. Le nom féminin alienatio, alienationis signifie :
- Transmission légale d'une propriété, aliénation, cession, vente
- Egarement, aliénation (de l'esprit), folie. C’est ce sens restreint du terme que nous avons retenu habituellement en français : « alienatio mentis » ou aliénation mentale qui signifie que la personne devient détachée des autres du fait de la perturbation de son esprit.
- Eloignement, défection, désaffection, mésintelligence, désunion, séparation, rupture, division, aversion.
Outre la notion de transmission de propriété à quelqu’un d’autre, le terme aliénation possède le double sens de devenir étranger à, avec en plus une notion d’animosité à l’égard de cette personne.
Un ou plusieurs enfants sont « annexés », prennent parti pour un de leurs parents et se coupent de l’autre, jusqu’à devenir agressifs ou hostiles. Dans les cas les plus graves, toute visite est impossible et parfois, le conflit va jusqu’au meurtre du parent détesté. Tout se fait comme si subitement, le monde (dans le sens microcosme dans lequel naviguent les enfants) se simplifiait en « bons » d’un côté et « méchants » de l’autre. Les enfants restent du côté du parent aliénant, le « bon » parent, la famille et les amis proches de ce bon parent, et le parent rejeté que nous appellerons aliéné est considéré comme le « méchant », avec le reste de sa famille à lui, et ses amis. Ce système est la résultante d’une manipulation essentiellement inconsciente du parent aliénant, et du comportement des enfants eux-mêmes, qui perçoivent le parent aliénant comme victime, et veulent le soutenir tout en s’assurant du maintien du lien qui les unit à celui-ci.
Malheureusement, les faits s’enchaînent sur un mode pervers et dans une chronologie telle, que l’entourage moins proche ne réalise pas ce qui se passe, et par acquiescement passif, entérine cette vision du monde. Plus le temps passe, plus cette version imprime la vie et les émotions de l’enfant aliéné, constitue sa réalité et dès lors devient « vraie ».
En somme, une fois le processus enclenché, aucune tendance spontanée de guérison ne s’observe, au contraire, la plupart des cas livrés à eux-mêmes évoluent vers la forme grave.
Il est certain que ce genre de situation ne date pas d’aujourd’hui. Le syndrome d’emprise existait déjà au sein de certaines familles n’ayant pas vécu la séparation. Cependant, le syndrome d’aliénation parentale se développe de manière exponentielle depuis l’avènement du divorce et la séparation accentue tout syndrome d’emprise préexistant. Les parents se séparant, les enfants sont souvent sommés de prendre part pour l’un ou l’autre et deviennent un « enjeu » très facilement pour les adultes. Un procès en justice peut cristalliser les conflits. Dans l’inconscient collectif, il y a un perdant et un gagnant, donc un bon et un méchant. La charge émotionnelle est telle que les parents oublient aisément que les enfants restent des enfants et ne doivent pas entrer dans ces conflits d’adultes. Dans ces conditions, cet enfant « enjeu » peut facilement passer du statut de sujet à celui d’objet. Et là se trouve le terreau de l’aliénation parentale. Mais rien n’est jamais affirmé aussi clairement, l’intérêt de l’enfant est toujours brandi comme l’obsession de chacun des deux parents. Pour un observateur extérieur non averti, ces conflits semblent inextricables et le mettent en échec.
Ce phénomène a été décrit relativement récemment aux Etats-Unis, et reste totalement méconnu en France. Aussi, pour l’instant, nous ne disposons d’aucun chiffre de prévalence et d’incidence. Mais pour un esprit informé sur l’aliénation, il suffit de s’intéresser à son entourage, pour réaliser que celle-ci est très fréquente, à des degrés divers. Etablir des statistiques est encore problématique, puisque ce sujet est tabou : le parent aliénant considère qu’il gère parfaitement une situation, tandis que le parent aliéné en plus de son rejet, de sa honte, est forcement soupçonné d’être un mauvais parent par le reste de la société. Pour quelqu’un qui n’a pas étudié le sujet, il est difficile d’imaginer qu’un rejet aussi massif ne puisse se fonder sur rien de répréhensible de la part du parent aliéné.
Pour s’appuyer sur des données très grossières, les chiffres qui circulent estiment qu’environ un mariage sur deux finit par un divorce actuellement. Le nombre moyen d’enfants par femme en France est de 2,1. Or il semble que le syndrome d’aliénation parentale concerne 5 à 10% des divorces, dont les 2/3 sont au stade grave.
D’autres chiffres indiquent que la moitié des enfants ne voit plus l’autre parent avec lequel ils ne vivent pas au bout de deux ans.
3.2. UN CAS PARTICULIER DE LA RELATION D’EMPRISE
Le syndrome d’aliénation parentale a été décrit par les anglo-saxons essentiellement, mais il s’apparente à ce que la littérature francophone nomme « relation d’emprise ». La pulsion d’emprise correspond au terme « Bemächtigungstrieb » de Freud utilisé pour la première fois en 1905 pour décrire une pulsion de domination par la force, à différencier de toute énergie sexuelle initialement. Il la rattache secondairement en tant que composante de l’érotisme et du stade anal, puis à la pulsion de mort.
R. Dorey a repris ce concept de pulsion d’emprise et l’a développé afin de décrire la « relation d’emprise ». Cette notion regroupe de nombreuses situations très variables, de la manipulation d’une nation à des situations intrafamiliales, en passant par les phénomènes sectaires et le harcèlement moral. Le but est de s’approprier l’autre en tant qu’objet de désir, de nier voire détruire sa différence, ce qui le fait « autre ». La relation est systématiquement pensée en termes de dominant/dominé, aucun autre type de relation n’est envisageable pour l’instigateur.
La victime d’une relation d’emprise est figée, paralysée, face à cet instigateur, sa seule issue est de courber l’échine. L’expérimentation animale a pu reproduire un comportement assimilable à celui de la victime. Des chiens ont été soumis à des décharges électriques répétées, alors qu’ils étaient attachés. Une fois libérés, ils n’avaient plus le réflexe de s’enfuir lorsque les décharges étaient de nouveau transmises.
Dans le SAP, la relation d’emprise est un peu particulière, car elle s’applique du parent aliénant sur le parent aliéné et les enfants à la fois. Et les enfants l’alimentent également en participant activement au meurtre symbolique du parent aliéné. Une relation d’emprise existe naturellement à minima entre les parents et les enfants. Mais dans les SAP, elle sort du cadre « normal ». Il n’y a plus de tiers, l’interaction devient fusionnelle et destructrice.
Gardner, par son travail sur le SAP, a approfondi la description d’un type très précis de relation d’emprise intrafamiliale confinant au pathologique. Cette étude lui a permis de dégager des orientations pour un diagnostic rapide et surtout des mesures simples et efficaces à appliquer rapidement pour protéger les enfants. Se focaliser sur un tel aspect a le bénéfice de sortir le soignant de l’impuissance dans la prise en charge thérapeutique d’une relation d’emprise.
3.3. LE CONTEXTE DU SAP
Pour arriver à la situation de SAP, des circonstances « favorables » doivent être réunies. Chacune de ces circonstances paraît dérisoire, voire négligeable prise isolément, pourtant telle une araignée qui tisse sa toile fil après fil, elles vont participer au piège qui se referme sur la famille éclatée. Dans certains cas, les évènements sont beaucoup plus dramatiques et précipités. Le scénario est violent, brutal, et demande à l’enfant de prendre position dans l’urgence. Revenir en arrière sera d’autant plus difficile.
3.3.1. Une separation conflictuelle
Tout d’abord, dans un SAP, le divorce est forcément conflictuel dès le départ. Peu de divorces se règlent à l’amiable, il est vrai. Mais si d’emblée, la séparation s’effectue dans le respect mutuel, le risque d’aliénation est quasiment nul. En revanche, une séparation conflictuelle est à haut risque pour les enfants. Cette évidence est à rappeler : tant que les adultes n’ont pas résolu leurs conflits, les enfants en pâtiront. Ils sont tout à fait capables de ressentir les tensions et les non dits, et se sentiront obligés de prendre part et de soutenir en apparence le parent le plus faible si les adultes ne les écartent pas clairement de cette situation.
Plus la situation sera tendue, plus un parent se sentira lésé, gardera un désir de vengeance ou de haine, plus l’enfant sera impliqué dans ce conflit, voire prié directement ou indirectement de prendre parti. Bref moins l’enfant se sentira en sécurité, plus il y aura risque d’aliénation. En d’autres termes, les parents doivent parvenir à séparer très nettement leurs dissensions de couple de la parentalité pour protéger l’enfant.
3.3.2. L’ENTOURAGE
Il joue un rôle fondamental dans la gestion de ces déchirements. Il représente une énorme masse passive si je puis dire, qui va participer à faire basculer la balance d’un côté ou de l’autre. Le parent aliénant imagine qu’il peut être le seul bon parent. Si l’entourage accepte sa vision du monde, il va la conforter. La question de l’individu ne se pose plus. C’est la somme des « regards extérieurs » qui va contribuer à faciliter l’installation de cette situation ou non. En bref, des voisins immobiles qui considèrent que chacun gère ses enfants comme bon lui semble et qui ne se permettront pas de dire que la situation est étrange, renforcent la position du parent aliénant. Le médecin qui ne pose pas la question du père ou de la mère absente facilite également la tâche de ce parent, même si cette interrogation va créer un grand malaise dans le cabinet. Comprenons-nous bien, il n’est en aucun cas question d’être intrusif dans la vie d’autrui, ni d’avoir un regard normatif sur l’autre, mais la tolérance n’est pas l’indifférence. Si personne n’interfère, la famille, puis certains amis, et ainsi de proche en proche une certaine masse de personnes vont contribuer à créer un cocon protecteur de cette situation anormale. Par leur silence, ils seront comme garants de la normalité de ce genre de relation pour le parent aliénant. Mais ils peuvent se montrer plus zélés et refuser à leur tour de revoir le parent aliéné décrit comme un monstre et cautionner ainsi la thèse du parent aliénant.
La vie est évidemment plus complexe. Le parent aliénant s’arrangera pour écarter les personnes qui ne soutiendraient pas sa cause. Le plus souvent les enfants aliénés sont progressivement « protégés » de toute mauvaise influence extérieure et évoluent dans un vase clos. Quant aux amis infidèles, eux aussi seront tout simplement rejetés voire calomniés.
L’entourage peut également participer activement et inciter à l’aliénation. Les parents du parent aliénant sont parfois les premiers à chercher à éliminer « l’autre » parent. Un nouveau conjoint peut trouver grand intérêt à créer ou encourager la zizanie afin de conforter sa place toute nouvelle.
3.3.3. L’HYPOTHESE FAUSSE FONDE LE SAP
Cette hypothèse va établir le socle du cercle vicieux de la haine et de l’incompréhension. Le parent aliénant réécrit l’histoire du divorce et convainc ses enfants en premier lieu, puis son entourage, de proche en proche de la véracité de sa version des faits. Il n’y a plus de place à l’alternative. Une seule version est possible, celle du parent aliénant, les autres sont fausses, et il va déployer toute son énergie à la rendre crédible. Les circonstances du divorce sont ainsi dramatisées, les scénarios réécrits chaque fois sous un jour plus péjoratif, il peut même y avoir de fausses allégations d’abus sexuel ou de maltraitance physique sur les enfants concernés. Le scénario le plus classique est : « Votre père est méchant, il nous a abandonnés ! » ou «C‘est à cause de votre mère que je souffre, je vais mettre fin à mes jours ! »
Le conflit est donc présenté sous des jours très différents par les deux parents. Aussi, l’entourage est souvent sommé par le parent manipulateur de prendre parti pour l’un ou l’autre, et il est difficile de démêler le vrai du faux, et ce, d’autant plus qu’on est toujours tenté de croire la version la plus dramatique, en supposant que l’autre version minimise les faits.
La méconnaissance des besoins fondamentaux des enfants dans la société, l’impuissance dans laquelle peut nous plonger ces conflits, la difficulté à obtenir des informations neutres renforcent la position du parent aliénant.
3.3.4. LE TEMPS EST UN AUTRE FACTEUR NON NEGLIGEABLE DANS LA FORMATION D’UN SAP
Et contrairement à ce que le sens commun voudrait croire, il en est l’ennemi implacable. Lorsque des enfants commencent à refuser de voir l’un des deux parents, à le rejeter, le compte à rebours est enclenché. Si personne ne vient en aide à cette famille à ce moment précis, la situation ne pourra que s’aggraver. Or, souvent, l’entourage intervient alors pour minimiser le problème et rappeler que le temps arrange tout. Ce n’est pas du tout le cas. Plus le temps s’écoule, plus le conflit se cristallise et plus il est difficile de revenir en arrière. Effectivement, même si le recul manque, les enfants peuvent finir par revoir le parent qu’ils ont rejeté autrefois, mais lorsque c’est le cas, c’est 10 ans, 20 ans, voire 40 ans après. Le temps a effectivement modifié la donne, mais à quel prix ?
Tout se passe comme si les hypothèses fausses de départ étaient validées chaque jour davantage. Les souvenirs se reconstruisent sur le modèle de la fausse hypothèse, et du côté du parent aliénant ainsi que des enfants aliénés, il est plus facile de se raccrocher à ce souvenir que de ressentir de la culpabilité et de regretter lorsque les choses sont allées trop loin. Du côté du parent aliéné, le temps contribue chaque jour à déliter le peu de lien qu’il restait.
Rappelons que la notion de temporalité ne s’inscrit pas de la même façon dans la tête d’un enfant que dans celle d’un adulte. Chaque année qui s’écoule voit la transformation physique et psychologique de l’enfant et de l’adolescent. Aussi, toute cette période sans l’un des deux parents est irrémédiablement escamotée. Le lien s’effiloche, et dans l’hypothèse d’un retour des enfants vers le parent aliéné, il ne sera plus jamais le même dans la majorité des cas. Les enfants resteront des étrangers. Heureusement, dans un nombre de cas non négligeable, le lien peut se reconstruire 10, 20 ans après en quelques minutes, comme si le parent aliéné et l’enfant s’était quittés la veille, mais avec le sentiment d’un énorme gâchis.
3.3.5. L’ARRIVEE AU SAP
- Une vision du monde faussée
Le parent aliénant instille peu à peu sa vision du monde dans le cerveau des enfants aliénés par le biais de techniques de manipulation développées ci-dessous, tout en éliminant systématiquement toute personne refusant d’approuver ce récit. Cette vision particulière les coupe de leur ancien entourage et va favoriser le travail de sape ultérieur.
- La frayeur
Elle n’est jamais avouée, mais représente un point clef de cette relation d’emprise. Ce peut être l’angoisse que le parent aliénant se suicide, qu’il n’aille pas bien car c’est le discours tenu aux enfants. Le parent aliénant peut effrayer également les enfants par ses attitudes et paroles manipulatrices, son langage à double contrainte, son regard plein de sous-entendus. Ce peut être également la peur du comportement du parent aliéné, diabolisé par le parent aliénant, qui entrave l’éventuel désir de liberté de l’enfant aliéné.
- Le devoir de loyauté
C’est l’assise de l’aliénation, la motivation essentielle des enfants. Les enfants comprennent très vite qu’ils sont invités à choisir entre deux parents. Le parent aliénant sous-entend que ce ne peut être que l’un OU l’autre, de manière exclusive. Tiraillés entre ces deux pôles, ils vont choisir le côté qui leur coûtera le moins d’énergie en apparence, c'est-à-dire le parent aliénant. Ce parent est souvent celui dont ils ont le plus peur d’être rejeté. Même s’ils se sentent soulagés dans l’instant, ils se retrouvent perdants, car ils sont prisonniers de l’un des parents, et obligé de trahir l’autre. Ce choix est en réalité un non-choix qui va conditionner ultérieurement le sentiment de l’enfant. Il proclamera avoir décidé par lui-même de refuser de visiter le parent aliéné.
Labels: PromotieOnderzoekSap, Wetenschap
Conseo.png)